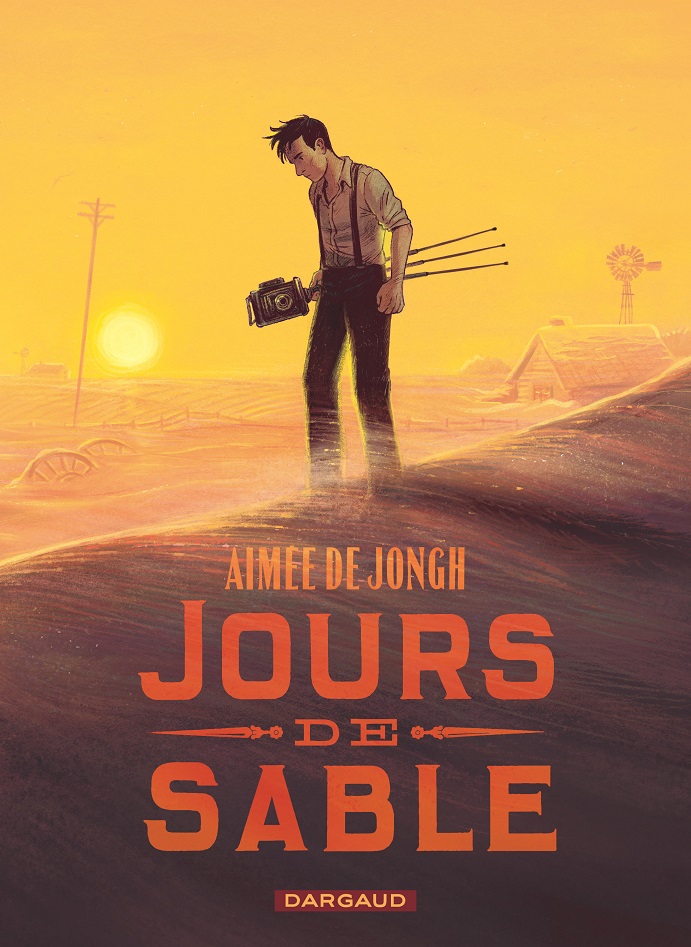Jours de sable / Aimée de Jongh
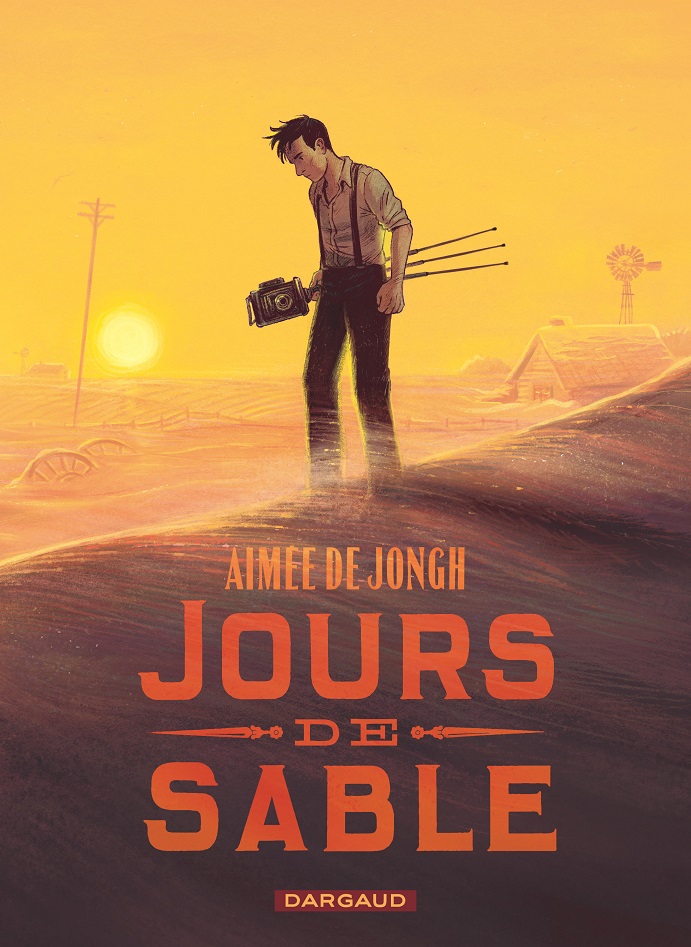
John Clark,
22 ans, devenu photographe pour exister aux yeux d'un père qui exerçait
ce métier mais n'a jamais prêté attention à son fils autrement que pour
lever la main sur lui, cherche un emploi plus intéressant que le poste
de journaliste aux faits divers qu'il occupe. Il est embauché par un
organisme gouvernemental qui veut documenter la vie des fermiers
américains pauvres, en particulier à la suite de la crise de 1929, afin
de mettre en place les structures d'aide que Roosevelt veut instaurer.
Pour cela, on cherche un photographe capable de rendre compte des
conditions de vie dans le « Dust Bowl » : une zone à
cheval sur le Kansas, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado et
l'Oklahoma. Cette zone a été nommée ainsi à cause des tempêtes de
poussière qui l'ont transformée en un véritable désert depuis quelques
années. Ce phénomène est dû en partie à l'activité humaine : les
fermiers se sont installés au début du 20e siècle, quand les terres
étaient bon marché. Ils ont installé des troupeaux qui ont brouté
l'herbe, et ont labouré de larges espaces, ignorant que c'était l'herbe
qui retenait la terre. Une fois l'herbe arrachée, la couche supérieure
de terre a commencé à s'éparpiller dans l'air au moindre coup de vent.
La poussière et le sable se sont mis à former d'épais nuages noirs.
C'est ainsi que le Dust Bowl est né, renforcé par la sécheresse et la
chaleur.
Muni de son matériel et d'une feuille de route, John
découvre cet enfer sur Terre, où vivent des familles totalement
démunies, tentées par l'exil. Il commence son travail de collecte en se
trompant beaucoup, car on lui a demandé des mises en scène
précises : des enfants orphelins, une famille sur le départ... Il
va progressivement comprendre que la photographie ne peut montrer que
la surface des choses, et que sa vocation est un fardeau dont il lui
faut se débarrasser. Pour cela, il lui faudra s'approcher au plus près
des êtres, comprendre ce lieu où les assiettes sont toujours posées à
l'envers sur la table pour éviter d'avoir à les essuyer sans cesse, où
les journaux servent à tapisser les murs pour limiter la pénétration de
la poussière dans les maisons, où l'outil de base à avoir avec soi est
une pelle, où l'oreiller au matin garde l'empreinte de votre tête
entourée de sable et où les enfants meurent de la « pneumonie de
la poussière ».
« J'ai appris combien la poussière diffère du sable. Le sable est
concret. On peut en sentir les grains quand ils glissent entre les
doigts. La poussière est beaucoup plus fine. On ne peut pas en
distinguer les particules. Etonnamment, la poussière semble se
comporter... comme de l'eau. Par conséquent, le paysage d'ici ressemble
à un océan secoué de vagues. Pour les gens du coin, de telles
distinctions comptent peu. Ils doivent vivre avec ces deux fléaux...
les nuits de poussière... et les jours de sable. »
Avoir partagé cela avec les gens d'ici change tout
pour John, qui décide de se mettre à vivre vraiment. Cet album raconte
un parcours bouleversant, dont la charge d'émotions est amplifiée par
son aspect documentaire. Des photographies d'époque jalonnent les pages
dont le dessin précis est parfois estompé par les atmosphères de
tempête de sable. Un cahier documentaire complète d'ailleurs l'ouvrage,
qui permet de comprendre plus en détail le programme de la FSA (Farm
Security Administration, qui mandate John dans l'histoire). Il nous
apprend que le Dust Bowl a disparu en 1939 avec le retour de la pluie,
mais que le réchauffement climatique peut faire craindre sa
réapparition malgré les progrès des techniques agricoles. Un très bel
album, à glisser dans les mains des professeurs d'histoire et
l'anglais, à proposer en fin de collège, au lycée et LP.
Références :
Jours de sable / Aimée de Jongh. Dargaud, 2021. 978-2-5050-8254-5. 29,99 €.